GEOLOGIE
du massif de la PUNTA SUELSA
Ce massif est original par sa géologie, résumée par
le schéma suivant, et illustrée par les cartes géologiques
de la page consacrée au topo.
(Pour en savoir plus sur la géologie de l'ensemble des Pyrénées, et sur celle de la région voisine qui, à l'ouest, de l'autre côté de la vallée du rio Barrosa, est centrée sur le cirque de Barrosa, aller, en cliquant ici, sur le site web consacré à ce cirque et réalisé par un membre du club (au chapitre " géologie ", y consulter plus particulièrement les pages " nappe de charriage " et " parcours géologiques " qui font allusion à la Punta Suelsa ; y voir aussi une page de photos qui détaille la géologie du versant nord de la Punta Suelsa vue du port de Plan).
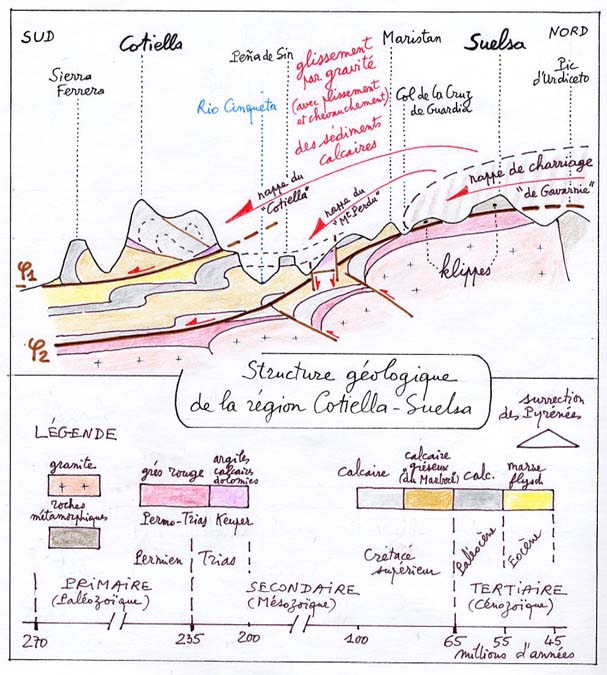
Schéma
expliquant la structure géologique des massifs de la Punta Suelsa et
du Cotiella.
1) LES GRES ROUGES
Avec
la Punta Fulsa voisine, la Punta Suelsa est le seul sommet pyrénéen de
prés de 3000 m constitué en grande partie de grès rouges (le grès
proprement dit, ou une roche argileuse voisine, dite " pélites lie-de-vin
", dont la friabilité explique l'aspect arrondi du relief) (voir la
photo 1 dans la page topo), reposant sur un socle de granite blanchâtre.
Il s'agit de roches sédimentaires arrachées par l'érosion
à l'ancienne et très vaste chaîne de montagne " hercynienne " érigée il
y a environ 300 millions d'années, puis déposées (à la fin de l'ère Primaire,
au Permien, et au début de l'ère Tertiaire, au Trias), par
des fleuves, dans les dépressions de cette chaîne, réduite, du fait de
cette érosion, à l'état de pénéplaine, et constituée de granite dans cette
région.
La couleur rouge provient du fait que celle-ci se trouvait
à l'époque dans en zone tropicale où le climat chaud et humide permettait
une dégradation poussée de certains minéraux, jusqu'au stade des oxydes
de fer, ce qui est le cas actuellement de la latérite.

Photos 2 et 3 :
- à gauche, coussinets de silène sur du grès rouge,
au-dessus du lac El Cao serti par des éboulis de granite blanc ;
- à droite, coussinet végétal (probablement de Silène
acaule) sur des pélites lie-de-vin.
2) LES KLIPPES
Autre
originalité : sur ces roches rouges (dont l'épaisse assise repose elle-même
sur du granite blanc) reposent deux " klippes ", dont l'une (voir
la photo 4 ci-dessous), bien repérable sur son versant sud, coiffe
le sommet de la Punta Suelsa, et l'autre un sommet secondaire, La Codera,
au sud.
Il s'agit de reliquats, épargnés par l'érosion, de
la vaste nappe de charriage (dite " de Gavarnie ") dont le chevauchement,
d'une dizaine de km vers le sud, sur le reste de la plaque tectonique
ibérique, est survenu il y a 40 à 50 millions d'année lorsque la collision
de la plaque ibérique contre la plaque eurasiatique a provoqué la surrection
des Pyrénées.
A noter qu'une autre klippe, beaucoup plus petite,
coiffe le sommet du pic Liena qui fait face à la Punta Suelsa à
l'ouest, de l'autre côté de la vallée du rio Barrosa. La nappe de charriage
a été mieux respectée par l'érosion plus à l'ouest dans les régions de
La Munia et surtout de Gavarnie (d'où son nom), où on repère son
front à la Hourquette d'Alans et au port de Boucharo.
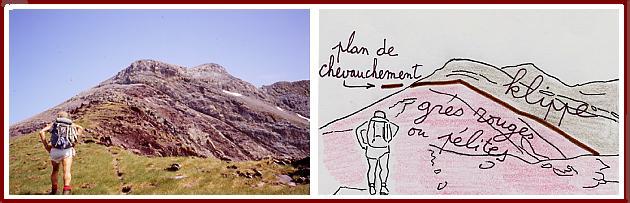
Photo 4,
montrant, sur l'arête sud de la Punta Suelsa, la klippe qui coiffe le
sommet.
3)
LES SEDIMENTS CALCAIRES (voir la photo 1 dans la page topo)
Le soulèvement de la chaîne axiale des Pyrénées, et
la mise en place de la nappe de charriage qui l'accompagne, a provoqué
le glissement vers le sud (avec plissement et fractures), de la couche
de sédiments calcaires qui s'étaient déposés sur la chaîne hercynienne
érodée, dans la mer qui l'avait recouverte à la fin de l'ère secondaire
(au Crétacé supérieur).
De façon plus précise mais schématique, la nappe calcaire
qui recouvrait la partie est des Pyrénées (où le soulèvement a commencé)
a glissé sur celle qui recouvrait la partie centrale ; les deux superposées
ont glissé vers le sud quand celle-ci s'est soulevé à son tour.
Ce sont ces sédiments qui constituent actuellement,
au sud de la Punta Suelsa, le pic Marista, les Peñas de la vallée de la
Cinqueta, et surtout le massif du Cotiella où on repère facilement
le plan de chevauchement des deux nappes calcaires superposées : il passe
en gros à hauteur de l'Ibon de Plan.
Haut
de page